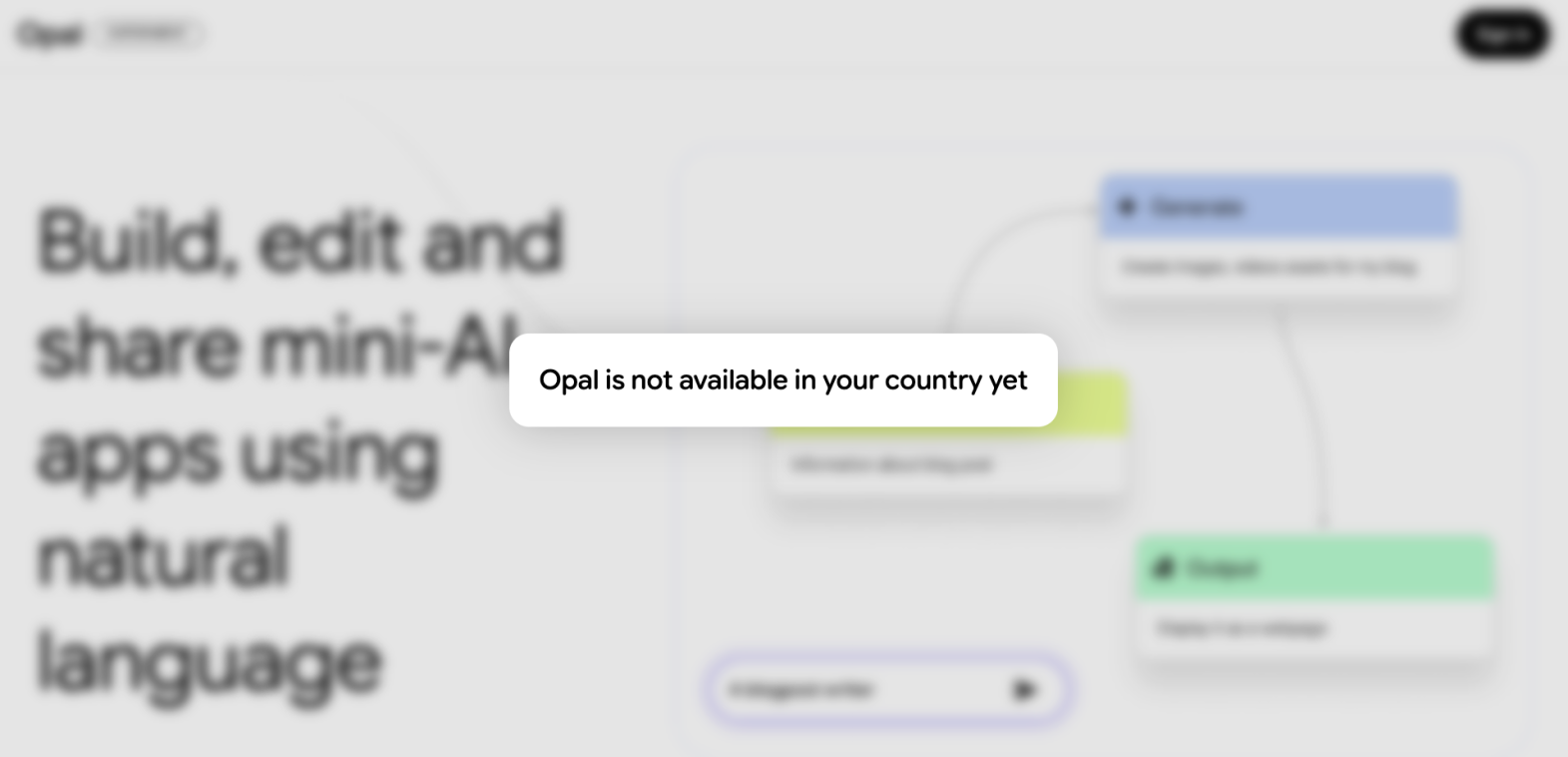Votre chatbot répond à côté de la plaque dès qu’on parle de vos produits ? Vos rapports générés par IA ne respectent jamais votre format interne ? Le fine-tuning est la clé pour transformer une IA générique en expert de votre entrepriseLe fine-tuning constitue la solution technique qui permet d’adapter un modèle pré-entraîné à vos cas d’usage particuliers en poursuivant son apprentissage sur vos données. Cette approche transforme un modèle générique en assistant spécialisé qui comprend votre vocabulaire, respecte vos formats, et produit des résultats alignés avec vos exigences métier.
Dans ce guide complet, vous découvrirez les différentes méthodes de fine-tuning, comment choisir entre fine-tuning et RAG, les coûts associés, et les meilleures pratiques pour réussir votre projet de personnalisation d’IA.
Qu’est-ce que le fine-tuning et pourquoi personnaliser un modèle
Le fine-tuning, ou affinage en français, désigne le processus de poursuite de l’entraînement d’un modèle de langage pré-entraîné sur un jeu de données spécifique à votre domaine ou votre tâche. Plutôt que d’entraîner un modèle from scratch, ce qui nécessiterait des millions de documents et des coûts astronomiques, le fine-tuning part d’un modèle déjà performant comme GPT, Llama, Mistral ou Gemma et l’adapte à vos besoins particuliers.
Pour comprendre l’intérêt du fine-tuning, imaginez que vous engagiez un expert généraliste brillant mais qui ne connaît pas les spécificités de votre secteur. Le fine-tuning, c’est comme lui offrir une formation intensive dans votre domaine. Il conserve toutes ses capacités générales (grammaire, raisonnement, culture générale) tout en acquérant une expertise pointue dans votre terminologie, vos processus, et vos standards de qualité.
Les modèles de langage généralistes comme GPT-4 ou Claude excellent sur une grande variété de tâches mais présentent des limitations pour des usages spécialisés. Ils ne maîtrisent pas nécessairement le jargon technique de votre secteur (médical, juridique, financier, industriel). Ils ne connaissent pas vos produits, vos services, ou votre historique d’entreprise. Leurs réponses suivent un style générique plutôt que votre ton de marque ou vos guidelines internes. Ils n’ont pas été optimisés pour vos formats de sortie spécifiques (rapports structurés, fiches produits, diagnostics médicaux).
👉 Voir aussi : comment exécuter des modèles d’IA en local sur votre ordinateur avec Ollama.
Le fine-tuning résout ces problèmes en ajustant les paramètres internes du modèle (les weights) pour qu’il intègre profondément vos connaissances domain-specific. Contrairement au RAG qui fournit du contexte externe au moment de la requête, le fine-tuning modifie le modèle lui-même de manière permanente. Le modèle « apprend » vraiment votre domaine plutôt que de simplement consulter des documents.
Les cas d’usage typiques du fine-tuning incluent la spécialisation sectorielle (créer un assistant médical qui comprend la terminologie médicale et respecte les protocoles cliniques), l’adaptation stylistique (entraîner un modèle à écrire dans le style de votre marque, avec votre ton, votre vocabulaire, et vos formulations), l’optimisation de tâches spécifiques (améliorer les performances sur une tâche précise comme la classification de tickets support, la génération de code dans un framework spécifique, ou la traduction technique), et l’alignement comportemental (ajuster le modèle pour qu’il adopte certains comportements, évite certains biais, ou respecte vos valeurs éthiques).
Selon les prévisions de PwC, d’ici 2027, 75% des systèmes d’IA en entreprise intégreront des LLM fine-tunés. Cette adoption massive témoigne de l’importance stratégique du fine-tuning pour créer des avantages compétitifs basés sur l’IA.

Les différentes méthodes de fine-tuning
Le fine-tuning n’est pas une technique unique mais plutôt une famille d’approches avec différents niveaux de complexité et de ressources requises.
Le full fine-tuning constitue l’approche la plus complète. Tous les paramètres du modèle (parfois des centaines de milliards) sont ajustés pendant l’entraînement. Cette méthode offre les meilleurs résultats possibles car le modèle peut s’adapter complètement à votre domaine. Cependant, elle nécessite des ressources de puissance de calculs considérables. Pour un modèle comme Llama 3.1 70B, le full fine-tuning requiert plusieurs GPUs haut de gamme (A100 ou H100) et peut prendre plusieurs jours. Les coûts se chiffrent facilement en dizaines de milliers d’euros. Le risque d’overfitting (sur-apprentissage) existe également, le modèle peut « oublier » certaines capacités générales en se sur-spécialisant.
Le PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) offre une alternative plus économique. Plutôt que d’ajuster tous les paramètres du modèle, le PEFT modifie uniquement un sous-ensemble stratégiquement choisi. Cette approche réduit drastiquement les besoins en mémoire et en calcul, rendant le fine-tuning accessible avec des ressources modestes. Les performances, bien que légèrement inférieures au full fine-tuning dans certains cas, restent excellentes pour la plupart des applications. Le risque d’overfitting est réduit car la majorité du modèle reste inchangée.
LoRA (Low-Rank Adaptation) représente la méthode PEFT la plus populaire en 2026. LoRA injecte des matrices de faible rang dans chaque couche du modèle. Ces matrices sont beaucoup plus petites que les poids originaux et sont les seules à être entraînées. Mathématiquement, au lieu de modifier directement une matrice de poids W, LoRA ajoute deux petites matrices A et B telles que la modification est A×B. Si W est de taille 1000×1000 (1 million de paramètres), A et B peuvent être de taille 1000×8 et 8×1000 (16 000 paramètres au total), soit une réduction de 98%.
Les avantages de LoRA sont multiples. La réduction de mémoire permet de fine-tuner des modèles de 70B paramètres sur une seule GPU grand public. L’entraînement est beaucoup plus rapide, souvent 5 à 10 fois plus court que le full fine-tuning. Les adaptateurs LoRA sont de petite taille (quelques centaines de Mo au lieu de plusieurs centaines de Go), facilitant leur stockage et leur partage. Vous pouvez créer plusieurs adaptateurs LoRA pour différentes tâches et les changer à la volée. QLoRA pousse l’efficacité encore plus loin en combinant LoRA avec la quantification, permettant de fine-tuner des modèles géants sur des GPUs modestes (24 Go de VRAM suffisent pour Llama 70B).
Le transfer learning constitue une approche plus traditionnelle. Un modèle pré-entraîné sur un vaste corpus généraliste est adapté à un domaine spécifique en l’exposant à des documents de ce domaine. Cette méthode fonctionne bien quand vous disposez d’une grande quantité de données non-labelisées dans votre domaine. Par exemple, pour créer un modèle juridique, vous pouvez continuer l’entraînement sur des milliers de jugements, contrats, et textes de loi. Le modèle apprend le vocabulaire juridique et les structures argumentatives typiques.
L’instruction fine-tuning optimise la capacité du modèle à suivre des instructions. Le dataset d’entraînement contient des paires (instruction, réponse attendue). Par exemple, « Résume ce document en 3 points », « Traduis ce texte en anglais », « Classe ce ticket support selon la catégorie ». Cette méthode améliore la capacité du modèle à comprendre et exécuter diverses instructions, rendant le modèle plus versatile et facile à utiliser. Des projets open source comme Alpaca (Stanford, 2023) ont démontré qu’avec moins de 100 dollars de coût de fine-tuning, on peut transformer un modèle open source comme Llama en assistant conversationnel compétent comparable à ChatGPT pour de nombreuses tâches.
Le RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) représente une méthode avancée qui aligne le modèle avec les préférences humaines. Le processus se déroule en trois étapes. D’abord, le modèle génère plusieurs réponses pour chaque prompt. Ensuite, des annotateurs humains classent ces réponses selon leur qualité (précision, utilité, sécurité, ton approprié). Enfin, un modèle de récompense est entraîné sur ces préférences, puis utilisé pour ajuster le LLM via apprentissage par renforcement. Cette approche produit des modèles plus alignés avec ce que les humains attendent réellement, améliore la sécurité en réduisant les réponses inappropriées ou dangereuses, et permet d’optimiser des critères subjectifs difficiles à capturer dans un dataset classique (politesse, empathie, créativité).
Le RLHF a été utilisé pour créer ChatGPT à partir de GPT-3.5, transformant un modèle brut en assistant conversationnel agréable et utile. Claude d’Anthropic utilise également intensivement cette approche. Cependant, le RLHF est coûteux car il nécessite beaucoup d’annotations humaines de qualité et complexe à implémenter correctement.
Fine-tuning vs RAG : quelle approche choisir
Le fine-tuning et le RAG (Retrieval-Augmented Generation) sont souvent perçus comme des alternatives, mais ils résolvent des problèmes différents et peuvent être complémentaires.
Le RAG excelle pour fournir des informations factuelles actualisées. Si vos données changent fréquemment (catalogues produits, réglementations, actualités), le RAG permet de mettre à jour la base documentaire sans toucher au modèle. Le RAG est rapide à mettre en place, ne nécessitant pas d’entraînement, juste l’indexation de documents. Il est transparent car vous pouvez voir quels documents ont été utilisés pour générer chaque réponse. Le RAG fonctionne bien même avec peu de données spécifiques, contrairement au fine-tuning qui requiert typiquement des milliers d’exemples.
Le fine-tuning excelle pour modifier le comportement intrinsèque du modèle. Pour apprendre un nouveau style d’écriture, un format de sortie spécifique, ou une manière de raisonner, le fine-tuning est supérieur. Il crée un modèle spécialisé qui « comprend » vraiment votre domaine, pas seulement qui consulte des documents. Les réponses sont plus naturelles et cohérentes car le savoir est intégré dans le modèle plutôt qu’assemblé à partir de fragments de documents. Le fine-tuning réduit la latence car il n’y a pas de phase de récupération de documents à chaque requête.
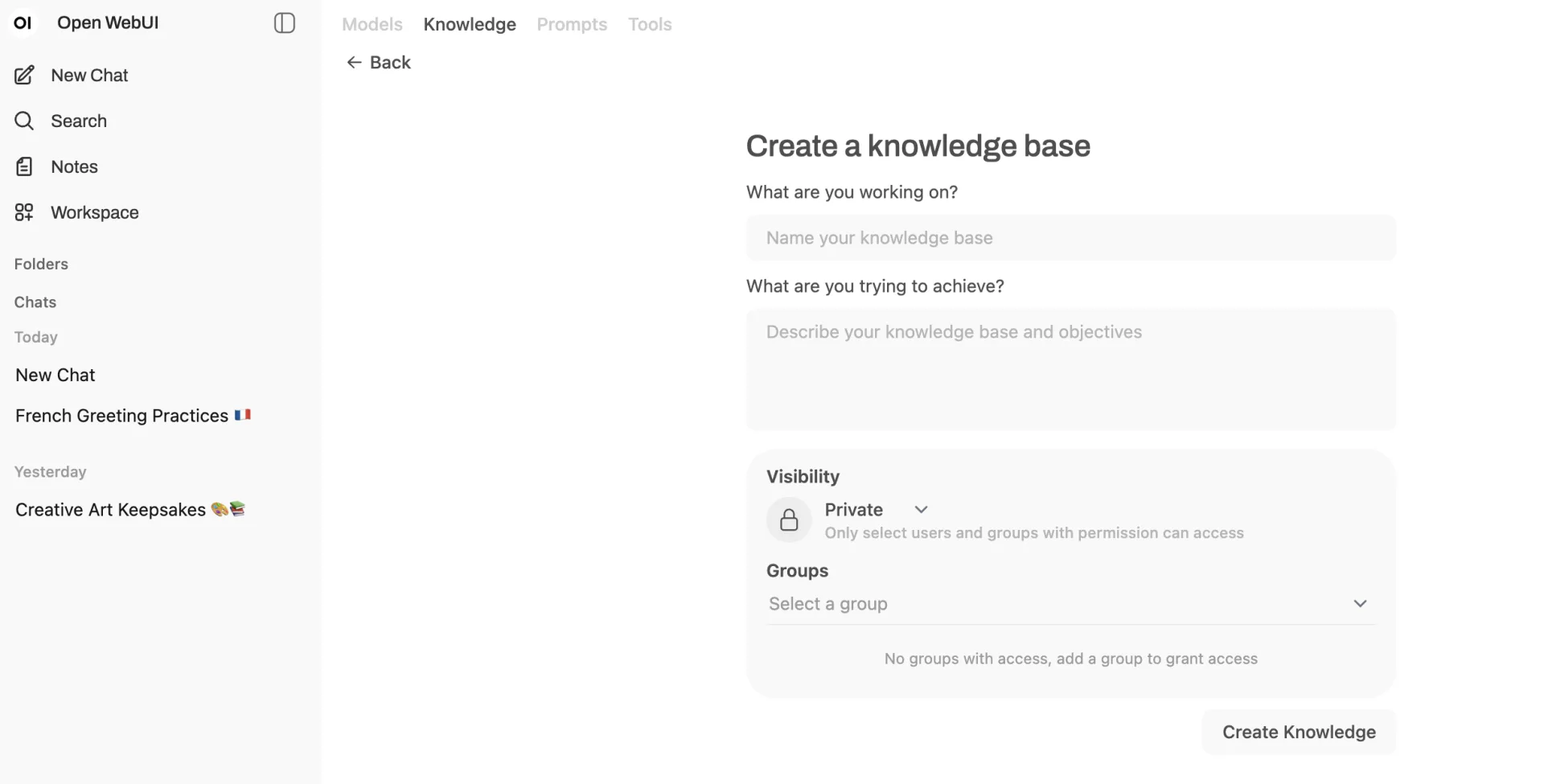
Les critères de décision pour choisir entre RAG et fine-tuning incluent plusieurs facteurs. Si vos données changent fréquemment (plus d’une fois par mois), le RAG est préférable. Si vos données sont relativement stables, le fine-tuning convient. Si vous avez moins de 1000 exemples de qualité, commencez avec le RAG. Avec 10 000 exemples ou plus, le fine-tuning devient intéressant. Si vous devez savoir précisément quelles sources ont informé chaque réponse, le RAG offre une meilleure traçabilité. Si vous voulez changer le style, le ton, ou le format des réponses, le fine-tuning est plus efficace. Si vous voulez ajouter des faits précis et actualisés, le RAG est plus approprié. Le fine-tuning a un coût initial élevé mais un coût d’inférence faible. Le RAG a un coût de setup modeste mais un coût d’inférence plus élevé (recherche vectorielle + contexte plus long).
L’approche hybride combine les forces des deux méthodes. Vous pouvez fine-tuner un modèle sur votre domaine pour qu’il comprenne votre vocabulaire et vos processus, puis utiliser le RAG pour lui fournir des informations factuelles actualisées. Par exemple, un assistant juridique pourrait être fine-tuné sur le raisonnement juridique et le style de rédaction, tout en utilisant le RAG pour accéder aux textes de loi les plus récents et à la jurisprudence. Cette combinaison offre le meilleur des deux mondes mais augmente la complexité technique.
Processus étape par étape pour réussir un fine-tuning
Un projet de fine-tuning réussi nécessite une approche méthodique qui va bien au-delà du simple lancement d’un script d’entraînement.
La première étape consiste à définir clairement l’objectif. Quelle tâche précise voulez-vous que le modèle accomplisse ? Plus votre objectif est spécifique, meilleurs seront les résultats. « Améliorer le modèle » est trop vague. « Générer des descriptions produits dans le style de notre catalogue, avec mention obligatoire des caractéristiques techniques et un ton enthousiaste » est précis et mesurable. Identifiez également vos métriques de succès. Comment saurez-vous que le fine-tuning a réussi ? Définissez des critères quantitatifs (précision, F1-score, perplexité) et qualitatifs (évaluations humaines sur des critères spécifiques).
La deuxième étape, souvent la plus chronophage, consiste à préparer le dataset d’entraînement. La qualité de vos données détermine directement la qualité du modèle fine-tuné. Pour le supervised fine-tuning, vous avez besoin de paires (input, output). Pour un modèle de génération de fiches produits, un input pourrait être les caractéristiques brutes d’un produit, et l’output la fiche produit rédigée parfaite.
La quantité de données nécessaire varie selon la tâche et la méthode. Pour du full fine-tuning, visez au minimum 10 000 à 50 000 exemples de qualité. Pour du PEFT comme LoRA, 1 000 à 10 000 exemples peuvent suffire selon la complexité. Pour de l’instruction fine-tuning simple, quelques centaines d’exemples bien choisis peuvent déjà donner de bons résultats. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Mille exemples parfaitement représentatifs valent mieux que dix mille exemples bruités.
Les données doivent être nettoyées et formatées correctement. Supprimez les doublons, corrigez les erreurs évidentes, anonymisez les données sensibles si nécessaire, et standardisez le format. Pour l’instruction fine-tuning, le format typique est un JSON ou JSONL avec des champs comme « instruction », « input » (optionnel), et « output ». Divisez votre dataset en trois parties : 80% pour l’entraînement, 10% pour la validation (ajustement des hyperparamètres), et 10% pour le test (évaluation finale sur des données jamais vues).
La troisième étape implique de sélectionner le modèle de base et la méthode. Choisissez un modèle pré-entraîné approprié à votre tâche. Pour du texte généraliste, Llama 3.1, Mistral, ou Gemma sont d’excellents choix open source. Pour du code, CodeLlama ou StarCoder. Pour des tâches multilingues, des modèles comme mT5 ou Bloom. Considérez la taille du modèle en fonction de vos ressources. Un modèle 7B fonctionne sur une seule GPU grand public (24 Go VRAM), un modèle 70B nécessite plusieurs GPUs ou du PEFT agressif. Décidez de la méthode de fine-tuning selon vos ressources et objectifs. Pour des ressources limitées, LoRA ou QLoRA sont idéaux. Pour des performances maximales et des ressources illimitées, le full fine-tuning reste supérieur.
La quatrième étape configure l’entraînement en ajustant les hyperparamètres. Le learning rate (taux d’apprentissage) détermine l’ampleur des ajustements à chaque étape. Trop élevé, le modèle diverge. Trop faible, l’apprentissage est lent. Typiquement entre 1e-5 et 5e-5 pour du full fine-tuning, et jusqu’à 1e-4 pour du LoRA. Le batch size représente le nombre d’exemples traités simultanément. Plus c’est élevé, plus l’entraînement est stable, mais plus cela consomme de mémoire. Ajustez selon votre GPU. Les epochs correspondent au nombre de passages complets sur le dataset. Commencez avec 3-5 epochs. Trop d’epochs causent de l’overfitting.
Pour LoRA spécifiquement, vous devez définir le rank (r), typiquement entre 4 et 64. Un rank plus élevé donne plus de capacité d’adaptation mais coûte plus cher. Commencez avec r=8 ou r=16. Le paramètre alpha contrôle l’échelle des modifications LoRA, souvent réglé à 2×rank.
La cinquième étape lance l’entraînement en utilisant des frameworks spécialisés. Hugging Face Transformers avec PEFT est l’option la plus populaire, offrant une excellente documentation et une communauté active. Axolotl simplifie le fine-tuning avec des configurations YAML simples et supporte LoRA, QLoRA, et full fine-tuning. Unsloth optimise spécifiquement LoRA et QLoRA pour des vitesses 2x plus rapides et 60% de mémoire en moins. LLaMA-Factory propose une interface low-code/no-code pour fine-tuner sans écrire de code. Pendant l’entraînement, surveillez les métriques. La loss (fonction de perte) doit diminuer régulièrement. Si elle stagne ou augmente, arrêtez et ajustez les hyperparamètres. La validation loss indique si le modèle généralise bien. Si training loss continue de diminuer mais validation loss augmente, vous êtes en overfitting.
La sixième étape évalue le modèle fine-tuné. Ne vous fiez pas uniquement aux métriques automatiques. Testez le modèle manuellement sur des cas réels. Comparez avec le modèle de base et éventuellement avec des modèles concurrents ou des solutions alternatives. Identifiez les forces et faiblesses. Le modèle excelle-t-il sur certains types de requêtes et échoue sur d’autres ? Collectez des feedbacks d’utilisateurs réels si possible. Leur perception de la qualité est souvent différente des métriques techniques.
La septième étape déploie et maintient le modèle. Une fois satisfait des performances, déployez le modèle en production. Pour les modèles LoRA, vous pouvez fusionner l’adaptateur avec le modèle de base ou charger l’adaptateur dynamiquement, ce qui permet de switcher entre plusieurs adaptateurs. Mettez en place un monitoring pour suivre les performances en production, collecter les cas d’échec, et détecter toute dérive de comportement. Le fine-tuning n’est pas une opération one-shot. Planifiez des cycles de mise à jour réguliers. Collectez de nouveaux exemples en production, réentraînez périodiquement pour intégrer les nouveaux patterns, et ajustez selon les feedbacks utilisateurs.
Coûts et ressources nécessaires pour le fine-tuning
Comprendre les coûts réels du fine-tuning permet de budgétiser correctement et de choisir la méthode appropriée.
Les coûts en infrastructure computationnelle varient énormément selon la méthode et la taille du modèle. Pour du LoRA sur un modèle 7B, une seule GPU grand public type RTX 4090 (24 Go VRAM) suffit. Coût : 1 500 à 2 000 euros à l’achat, ou environ 0,50 euro/heure en location cloud. Durée typique : 2 à 8 heures selon la taille du dataset. Coût total : quelques euros à quelques dizaines d’euros.
Pour du LoRA sur un modèle 70B avec QLoRA, une GPU A100 40 Go ou H100 est recommandée. Coût : environ 2 à 4 euros/heure en location cloud. Durée : 6 à 24 heures selon dataset et optimisations. Coût total : 12 à 100 euros typiquement.
Pour du full fine-tuning sur un modèle 70B, plusieurs GPUs A100 ou H100 en parallèle sont nécessaires (4 à 8 GPUs minimum). Coût : 10 à 40 euros/heure pour un cluster. Durée : 1 à 7 jours selon le dataset. Coût total : plusieurs milliers à dizaines de milliers d’euros.
Les principales plateformes cloud offrent des services dédiés. AWS SageMaker propose des instances GPU optimisées avec intégration facilitée. Google Cloud Vertex AI offre un environnement complet pour le fine-tuning avec des modèles pré-configurés. Azure Machine Learning fournit des outils de fine-tuning intégrés avec MLOps. Hugging Face AutoTrain permet le fine-tuning sans code via interface web, avec tarification à l’usage. RunPod, Lambda Labs, et Vast.ai offrent des locations de GPU à la demande souvent moins chères que les grands clouds.
Certains fournisseurs d’API proposent le fine-tuning as a service. OpenAI permet de fine-tuner GPT-3.5 et GPT-4 via API, avec tarification basée sur le nombre de tokens d’entraînement (environ 0,008 euro par 1000 tokens) plus un coût d’usage du modèle fine-tuné légèrement supérieur au modèle de base. Anthropic prévoit des services similaires pour Claude. Together.ai et Fireworks.ai proposent le fine-tuning de modèles open source avec tarification compétitive.

Les coûts humains ne doivent pas être négligés. Un data scientist ou ML engineer pour préparer les données, configurer l’entraînement, optimiser les hyperparamètres (1 à 4 semaines selon la complexité). Des annotateurs pour créer ou valider le dataset d’entraînement si vous n’avez pas de données existantes (plusieurs semaines à mois selon le volume). Un MLOps engineer pour déployer et monitorer le modèle en production (quelques jours à quelques semaines).
Le coût total pour un projet de fine-tuning typique d’entreprise se situe entre 5 000 et 50 000 euros pour un POC (Proof of Concept) avec LoRA sur modèle moyen, dataset de 1 000 à 10 000 exemples, 2-4 semaines de travail. Pour un déploiement production, comptez 30 000 à 150 000 euros avec full fine-tuning ou LoRA sur gros modèle, dataset de 10 000 à 100 000 exemples, infrastructure robuste, 2-3 mois de travail. Pour un projet enterprise complexe avec plusieurs modèles spécialisés, RLHF, monitoring avancé, prévoir 150 000 à 500 000 euros.
Les économies à long terme peuvent être substantielles. Un modèle fine-tuné plus petit (7B) peut souvent remplacer un modèle généraliste géant (GPT-4) pour votre tâche spécifique, réduisant les coûts d’API de 90% ou plus. Les performances améliorées réduisent le besoin de re-prompting, économisant tokens et temps. L’hébergement on-premise d’un modèle fine-tuné élimine les coûts API récurrents après l’investissement initial.
Défis et bonnes pratiques
Le fine-tuning comporte des pièges qu’il faut connaître pour les éviter.
L’overfitting représente le risque principal. Le modèle mémorise le dataset d’entraînement au lieu d’apprendre des patterns généralisables, fonctionnant parfaitement sur les exemples d’entraînement mais mal sur de nouvelles données. Pour l’éviter, utilisez suffisamment de données variées, arrêtez l’entraînement dès que la validation loss commence à augmenter (early stopping), appliquez des techniques de régularisation (dropout, weight decay), et augmentez artificiellement votre dataset (paraphrases, synonymes, variations).
La catastrophic forgetting constitue un autre défi. En se spécialisant sur votre tâche, le modèle peut « oublier » des capacités qu’il avait avant. Par exemple, un modèle fine-tuné pour le juridique pourrait perdre sa capacité à écrire de la poésie. Pour mitiger ce problème, préférez le PEFT (LoRA) au full fine-tuning, incluez des exemples variés dans votre dataset pour maintenir les capacités générales, utilisez un learning rate modéré, et testez régulièrement le modèle sur des tâches variées.
La qualité des données détermine tout. Des données bruitées, biaisées, ou non représentatives produiront un modèle médiocre. Investissez massivement dans la curation des données, faites auditer vos données par des experts du domaine, testez sur un petit échantillon avant de scaler, et itérez sur le dataset si les résultats sont insatisfaisants.
Le déséquilibre des classes peut poser problème. Si votre dataset contient 90% d’exemples de la classe A et 10% de la classe B, le modèle apprendra surtout A. Équilibrez votre dataset en sur-échantillonnant les classes minoritaires ou sous-échantillonnant les majoritaires, utilisez des fonctions de perte pondérées qui pénalisent plus les erreurs sur les classes rares, ou créez des datasets synthétiques pour les classes sous-représentées.
Les biais dans les données se retrouvent dans le modèle. Si vos données d’entraînement contiennent des biais (genre, race, âge), le modèle les reproduira. Auditez vos données pour détecter les biais, équilibrez la représentation de différents groupes, testez le modèle spécifiquement pour des réponses biaisées, et implémentez des guardrails pour filtrer les sorties problématiques.
Le choix des hyperparamètres impacte grandement les résultats. Ne vous contentez pas des valeurs par défaut. Explorez méthodiquement différentes valeurs, utilisez des techniques de recherche d’hyperparamètres (grid search, random search, ou bayesian optimization), documentez vos expériences pour comprendre l’impact de chaque paramètre, et commencez avec les recommandations de la communauté pour votre type de modèle et tâche.
Les bonnes pratiques incluent plusieurs recommandations. Commencez petit avec un POC sur un sous-ensemble de données et un modèle plus petit avant de scaler. Versionnez tout : données, code, hyperparamètres, et modèles avec des outils comme DVC, MLflow, ou Weights & Biases. Documentez exhaustivement chaque expérience, les choix effectués, et les résultats obtenus. Automatisez le pipeline d’entraînement pour pouvoir réentraîner facilement. Testez en conditions réelles avant le déploiement production, pas seulement sur des benchmarks. Planifiez la maintenance avec un processus pour collecter les feedbacks, identifier les faiblesses, et réentraîner périodiquement. Respectez la propriété intellectuelle en vérifiant que vous avez le droit d’utiliser vos données d’entraînement et que le fine-tuning respecte la licence du modèle de base.
Questions fréquentes
Le fine-tuning consiste à réentraîner un modèle de langage pré-entraîné sur vos propres données pour l’adapter à un domaine ou une tâche spécifique.
Cela permet à l’IA de comprendre votre vocabulaire, votre ton et vos formats, offrant des réponses plus pertinentes et alignées avec vos besoins métier.
Le fine-tuning modifie le modèle lui-même pour intégrer vos connaissances, tandis que le RAG ajoute du contexte externe au moment de la requête.
Un projet simple avec LoRA peut coûter quelques centaines d’euros, tandis qu’un fine-tuning complet peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros selon la taille du modèle et les ressources.
Les modèles open source comme Llama, Mistral, Gemma ou Bloom sont les plus couramment fine-tunés, mais certains modèles propriétaires (comme GPT-4) le permettent via API.
Oui, via des services cloud ou des plateformes comme Hugging Face, RunPod ou AWS SageMaker, qui fournissent les ressources nécessaires à la demande.
Les plus populaires sont Hugging Face Transformers, PEFT, Axolotl, LLaMA Factory et Unsloth.
Non, ils sont complémentaires : le fine-tuning apporte la spécialisation, tandis que le RAG assure l’accès à des données actualisées.